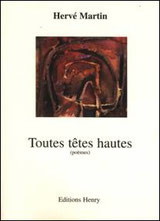Anatolie
Marie Étienne
Éditions Flammarion/Collection Poésie 1997
Marie Étienne a écrit une dizaine d’ouvrages de poésie parmi lesquels Blanc clos son premier ouvrage, Lettres d’Idumée, La Longe et Le Sang du guetteur. Anatolie est son dixième livre de poésie. Elle est également l’auteur de nombreux récits et écrits sur le théâtre autour d’Antoine Vitez, Professeur, metteur en scène et poète, dont elle fut longtemps l’assistante.
Le livre est un voyage en Anatolie, pays de tradition orale dont la force réside dans la mémoire des hommes.
Il est un tout et son propos est la parole — inscrite – à profusion de formes. Tentative démesurée à l’échelle humaine de vouloir questionner, réinterroger, réinventer la vie en multipliant la forme : les paroles possibles. Scènes sous éclairages différents, jeux d’ombres, reflets, pénombres, mouvements et déplacements fugaces : sur la scène de la vie en reconstruction, Marie Étienne propose d’autres possibles.
L’ouvrage est composé de 16 ensembles alternativement écrits en prose et en vers, dans des poèmes dont la forme varie : quatrains rimés et dizains notamment.
Du premier ensemble intitulé « La ville peinte » au dernier nommé « théâtre » il semble qu’une boucle achève son périple en se refermant sur elle-même, après maintes variations de l’écriture — de la parole —, le théâtre n’est-il pas une forme de vi (ll) e peinte ?
Comment lire.
Comment lire cet ouvrage ? Dans l’ordre des ensembles à laquelle la pagination nous contraint ? Faut-il d’abord lire les proses comme les différents chapitres d’un même ouvrage puis à la suite les poèmes ? Ou inversement ! Ou peut-être, lire au hasard des pages un poème puis une prose ?
En désordre ?
Ce qui n’est pas ordonné. Ce qui apparaît subitement sous nos yeux, le trajet de nos pas, sur notre peau, qui surgit ! La vie qui avance sur nous. Lire ainsi et recréer alors comme l’aléa posthume d’un temps qui est passé.
La première phrase du livre nous y invite. Conspuant clairement l’ordre d’une narration classique, Marie Étienne nous entraîne dans cette ville peinte, nous faisant perdre « pied » dans une prose onirique qui me fait penser à un rêve éveillé de Robert Desnos.
Un voyage sur place.
Dès les poèmes intitulés L’Appel, La Toilette tout semble là ! Les planches, l’éclairage, le rideau, les spectateurs.
Du monde ou scène de théâtre j’aime
La vérité douteuse des décors
Les souvenirs ici sont explorés, revisités par des poèmes composés de strophes aux formes différentes : quatrains, neuvains ou dizains. Certains de ces derniers, composants les poèmes des ensembles La Morelle, Nuits ocre ou La Jeune Fille aux rats, débutent par le dernier vers du dizain précédent, comme une métaphore visuelle d’un baisser et un lever de rideau. Ou encore, d’autres strophes de huit à dix vers dans Instructions pour pleurer réunies entre elles de la même manière et dans un entrelacement de parenthèses transformant le poème en un chapelet de souvenirs : un rosaire à égrener.
Les épisodes de la vie sont « Actes », à revivre. À répéter ? C’est vers cette quête que s’élance le comédien, vers cet espace où le lieu et l’être se confondent.
On veut percer l’énigme
et ceux-ci
L’énigme est quelque part, si désirable.
On l’avait mise dans un corps, elle n’y était pas.
Ce que l’on met entre parenthèses — dans des silences ?- est peut-être bien le plus important !
Ce qui tient un projet, c’est bien ce qui l’affirme, la force de l’affirmation.
L’Anatolie.
Pays d’une civilisation disparue de tradition orale, l’Anatolie nous apparaît comme le pays d’une genèse personnelle et celui confondu du mont Ararat où le monde recommença. Sur chaque page deux parties différentes et complémentaires de ce même et long poème. L’une en vers, la seconde en prose s’épousent comme deux blocs d’un seul ensemble délimitant des frontières, des géographies intimes, des territoires : labyrinthe où s’imbriquent deux terres d’Ararat, la singulière et celle plus tangible où se posent nos pas.
Ce pays de paroles, serait-ce le théâtre ? Ce lieu où texte de comédien et indications de l’auteur se joignent, s’unissent ?
Se vivifiant de la réminiscence, le poème retrace une ligne de mots, des vers mêlés de désir et de perte immanents.
« celui que je désire arpente-la
planète »
Un manque, une douleur de l’amour, cet objet de la quête, forment une « bleuissure » qui apparaît à mesure que nous progressons dans cette région intérieure.
à quelle dame en noir
dérobes-tu sa peau ?
Seule la parole — ce souffle — peut colmater la brèche, inonder le silence.
il ne
me reste que la langue
enveloppée
avec des linges
livrant passage
entre les herbes
Marcher sur ses brisés.
Nuits agitées de rêves, souvenances emmêlées à nos pas d’aujourd’hui : l’enfance accompagne toute la vie. Elle sourd dans les jours, les secondes des nuits. Alors, comment ne pas
« se cogner à l’angoisse »
et désirer effacer des scènes terriblement insensées, qui surgissent, impromptues. Le poids des moments vécus imposés à l’enfance leste chaque instant de la vie.
Est-il que mon amour a une odeur
Insupportable et que mes vêtements
Robes capes manteaux déshabillés
De soie pendent souillés de traînées blanches
À mesure que nous avançons, la réalité glisse, se délite en cauchemar. Le désir se brouille et l’inquiétude envahit.
On se fait un chemin du passé. Voilà la vie : marcher sur ses brisés.
on est le passage le bas du corps est la vallée
Que penser alors de la couleur bleue qui revient à plusieurs reprises ?
Azur du ciel ou bleus du corps ?
Le théâtre, le monde.
La forme des poèmes réinvestit et s’approprie le lieu du souvenir. Les reflets, les éclats, les miroitements du miroir aux alouettes de notre mémoire sont changeants.
Nulle vie à nulle autre pareille.
Le placement de l’observateur, la scène observée, l’angle de vue, l’univers intérieur –- chambre noire — : Tout dans le monde est singulier. Unique ! La réalité, c’est la multiplicité des regards, la multiplication des ponts, des passerelles. Peut-être alors le nombre de répétitions, la variation des répliques, les tonalités des voix, l’intensité des regards nous en dit plus sur nous-même que le cours incessant de la vie ne le fait ?
En multipliant la forme, Marie Étienne ouvre des brèches, perce des coulées et traverse l’apparence première de la réalité. Elle nous offre l’opportunité d’interroger le sens de notre univers singulier : « Ce » que chacun de nous appelle le monde.
hm
 Hervé Martin
d'Igny
Retrouveras-tu/ la frêle/ langoureuse indécision/ de ces matins emplis/ de prometteuses/
hypothétiques lueurs/ qui te firent avancer/ Alerte/ vers ce pays/ où nul/ n'échappe vivant (Toutes têtes hautes)
Hervé Martin
d'Igny
Retrouveras-tu/ la frêle/ langoureuse indécision/ de ces matins emplis/ de prometteuses/
hypothétiques lueurs/ qui te firent avancer/ Alerte/ vers ce pays/ où nul/ n'échappe vivant (Toutes têtes hautes)